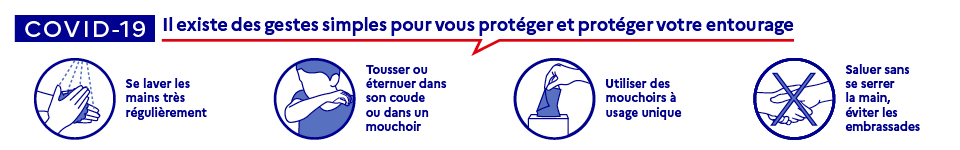La mise en examen est une décision prise par un juge d’instruction à l’encontre d’une personne, à l’issue d’un interrogatoire de première comparution. Elle consiste à faire porter les investigations sur une personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants, qui rendent vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la réalisation d’un crime ou d’un délit. La personne mise en examen a le droit à un avocat et peut également demander au juge de procéder à tout acte lui paraissant nécessaire à la manifestation de la vérité : auditions, confrontations, expertises…
Le juge peut prononcer, à l’encontre du mis en examen, une mesure de contrôle judiciaire ou saisir le juge des libertés et de la détention (JLD), s’il estime qu’un placement en détention provisoire est nécessaire.
La personne mise en examen demeure présumée innocente jusqu’à ce qu’elle soit jugée devant un Tribunal correctionnel (pour les délits) ou une Cour d’Assises (pour les crimes). C’est le juge d’instruction qui décide de renvoyer ou non, à la fin de l’information, la personne mise en examen devant la juridiction répressive. Sa décision s’appelle une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel (ORTC) ou ordonnance de mise en accusation (OMA). Si le juge estime, à la fin de l’information judiciaire, qu’il n’existe pas assez de charges contre la personne mise en examen pour la renvoyer devant la juridiction, il prononce une ordonnance de non-lieu.
La durée d’une information judiciaire est très variable mais est bien souvent très longue, d’une à plusieurs années, du fait de raisons variables (surcharge des cabinets d’instruction, complexité des investigations et délais des retours de commissions rogatoires, d’expertises, …).
Si une personne soupçonnée n’est pas placée en examen à l’issue de l’interrogatoire de première comparution, elle bénéficie du statut de témoin assisté dans la procédure.
Références législatives :
Autre recherche ?
Écrivez un mot-clé :